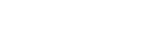Dans cette partie :
Quels supports ?
- Formations
- Echanges bout de champ
- Plateforme d’essais
- Visites de groupes
- Démos de matériels
- Ateliers de co-conception
- …
Comment mettre en place des expérimentations ?
-
Objectif de l’expérimentation
Dans sa thèse “Analyse des tests de pratique des agriculteurs : en quoi facilitent-ils le passage vers l’agroécologie ou l’agriculture biologique“, Maxime Catalogna a repéré trois processus liés à l’expérimentation :- Collecter des preuves de l’intérêt de la pratique. Celle-ci permet une validation par les pairs de la pratique innovante mise en œuvre : cela passe par des preuves collectés montrant l’intérêt de la pratique ; des résultats visibles et facile à appréhender tels que :
- Les résultats culturaux,
- L’état du système agro-écologique (état du sol, pression des bioagresseurs…)
- Les services écosystémiques rendus (biomasse, reliquats d’azote)
- La faisabilité et la reproductibilité (temps alloué, problèmes éventuels à la mise en œuvre de la technique)
- Modifier la pratique à la marge
Une expérimentation ne révolutionne pas tout le système, du moins pas au départ, elle modifie tout de même les pratiques : Exemple :- Décalage des dates de semis
- Développement d’un mélange = volonté d’optimiser une pratique déjà existante
- Transformation d’une pratique
- Explorer
- Découverte de différentes « formes » possible ou non de la pratique
- Transfert d’une pratique expérimentée sur une autre culture, ou avec ses propres modifications.
Pour en savoir +
- INRA Unité Ecodéveloppement: «An agronomical framework for analyzing farmers’ experiments (EN) »
- Collecter des preuves de l’intérêt de la pratique. Celle-ci permet une validation par les pairs de la pratique innovante mise en œuvre : cela passe par des preuves collectés montrant l’intérêt de la pratique ; des résultats visibles et facile à appréhender tels que :
-
Modalités de l’expérimentation
Le collectif peut choisir de mettre en place des expérimentations :- Ponctuelles : Sur quelques hectares, sur un nombre limité d’animaux, en faible quantité dans la ration, avec un protocole et un suivi peu établi
- Protocolaires : Une expérimentation structurée bénéficiant d’un suivi précis des parcelles concernées, rations testées par l’expérimentation et un accompagnement des organismes de développement agricole avec des protocoles très explicites. Ces expérimentations plus structurées répondent aux besoins en références techniques « au champ », diffusables et transférables concernant les innovations agroécologiques.
L’ampleur des expérimentations peut aussi progresser au fil de l’expérimentation, dans la prise de risque. De quelques hectares, il peut être intéressant de structurer l’expérimentation et de voir l’évolution dans l’engagement en relation avec l’évolution de la prise de risque MAIS attention à ce que le nombre d’hectares soit suffisant pour avoir des résultats observables et tangibles.
- La durée de l’expérimentation s’effectuera sur du moyen-long terme, seul ou à plusieurs, avec des moments en collectif (ex : la récolte) et d’autres en individuel (ex :le suivi de l’itinéraire technique), accompagné ou non d’un animateur de réseau et/ou partenaires du développement agricole.
-
Mise en commun du travail individuel
Certains groupes mutualisent l’ensemble du processus d’expérimentation de la co-construction du protocole au partage des résultats. D’autres font le choix de gérer individuellement la mise en place et la gestion de l’expérimentation. La partie collective ne concerne alors que le partage des résultats.
-
Rôle de l’accompagnement
L’accompagnateur a pour rôle d’aider à resituer les objectifs, les modalités et les ressources dans l’itinéraire d’expérimentation, dans le processus d’apprentissage, dans l’histoire et le fonctionnement des collectifs. Il aide également le groupe à formaliser les résultats et à les mobiliser pour concrétiser de réels changements sur l’exploitation.
-
Rôle de la recherche
Certains groupes sont accompagnés dans le cadre de projets impliquant la recherche. Le fait de travailler avec des chercheurs apporte une certaine rigueur qu’il n’y avait peut-être pas avant.De plus, il y a aussi un enjeu d’hybridation des connaissances et des apprentissages mutuels dans ce type de projet : le rôle de la recherche n’est pas uniquement descendant.
Témoignages
Le collectif ça amène vraiment quelque chose.

Témoignage vidéo de deux agriculteurs sur la mise en place d’échanges éleveurs-céréaliers.
Une dynamique de groupe solide

L’arrivée de l’autochargeuse combiné aux changements de pratiques (intégration de nombreuses légumineuses) a permis de créer une dynamique de groupe solide.
Il faut être leader de l’animation mais pas des idées.
Cuma des 4 saisons, la vie du sol avant tout !
Chez nous le séchage est en prestation complète . Le prestataire détient l’autochargeuse. et chaque agriculteur récupère son fourrage

Le séchage en collectif : pourquoi ? comment ? quels impacts sur mon exploitation ? Réponses ici
Des céréaliers intéressés, on peut en trouver mais le nœud du problème c’est de trouver des débouchés et des éleveurs qui y trouvent leur compte
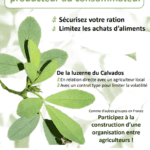
Création d’une filière Luzerne territoriale : les leçons d’un échec.
Une formation Luz’co au format intéressant

une approche active partant des constats des participants dans leurs pratiques couplée à la mobilisation d’une diversité d’apports d’autres projets”.
Toute les infos ici.
Le développement des légumineuses fourragères (et tout autre démarche agroécologique) en collectif nécessite-t-il un accompagnement spécifique ?

La réponse ici
s’il y a des problèmes, je les gère, je les assume, je les répare

Il faut toujours que quelqu’un prenne des risques. Ici, s’il y a des problèmes, je les gère, je les assume, je les répare. C’est un fonctionnement qui convient à eux comme à moi. , cogérant de l’unité de méthanisation FERTIWATT et de l’unité de séchage mise à disposition du collectif Alumé.
Lire l’intégralité du témoignage ici
Plus d’informations sur le séchage en collectif ici
[…] Il n’y a pas que le financier et l’agronomie…

C’est assez complexe car plusieurs facteurs entrent en jeu. Il n’y a pas que le financier et l’agronomie : le respect des calendriers des travaux, qui fait quoi, les protocoles à établir… Dynamix permet d’aborder toutes les choses auxquelles on ne pense pas au premier abord
Découvrez le témoignage vidéo ici
Plus d’informations sur la mise en place d’échanges gagnants-gagnants ici
On peut mettre n’importe quel sujet derrière, c’est la méthode qui fonctionne

On peut mettre n’importe quel sujet derrière, c’est la méthode qui fonctionne : travailler sur des études de cas, sur des problématiques territorialisées, avec un tissu professionnel au service de l’enseignement agricole.
Témoignage vidéo ici
Toutes les informations sur cette expérience ici